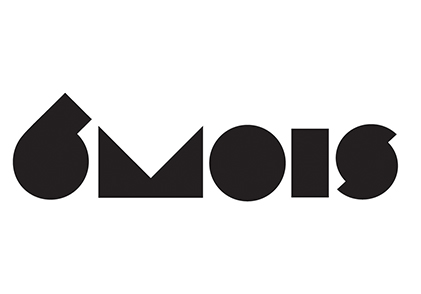Lorsqu’elle ne trouve pas ses mots, son nez se fronce, ses lèvres se tordent.
« C’est… »
Elle se concentre. De toutes ses forces.
« Hmm… C’est de la… »
Et d’un mouvement de tête, elle abandonne.
« It’s some fucking octopus. »
En français, ça veut dire que ce qu’elle me tend là, dans son assiette en carton, ce machin en forme de boules de pâte gluantes, c’est de la pieuvre.
« Spécialité nippone, le takoyaki. Ils découpent l’octopus en morceaux, ils mettent dans de la pâte et ils grillent. »
Elle me colle l’assiette sous le nez.
« Eat. »
Ça veut dire mange. Alors je prends l’assiette, et je cherche sur le stand s’il n’y a pas des cuillères en plastique. Des baguettes. Quelque chose.
« Comment je suis censé faire ?
– Mets dans ta bouche, banane. »
Elle m’a déjà tourné le dos, elle s’éloigne.
Au bas de la nuque, elle s’est fait tatouer le symbole du Yin et du Yang.
Je m’apprête à demander aux vendeurs s’ils n’ont pas des couverts, mais les résidents du Japon sont déjà affairés à servir de nouveaux clients. C’est le principe de ce week-end, la fête de la cité U. Chaque maison du parc représente le pays duquel elle tire ses origines, leurs occupants cuisinent des spécialités. Ils proposent des expos, des spectacles.
« Oh ! »
Je me tourne vers cette fille, elle a les mains sur les hanches.
« Tu me dois encore deux réponses ! Alors tu me suis. OK ? »
OK, OK… Je l’ai rencontrée il y a quoi ? Une heure, à peine. Je me baladais dans la Cité, je découvrais cette fête, sans but précis. Aux abords du Mexique, j’ai croisé le regard de cette fille qui s’est précipitée vers moi et m’a interpellé avec son accent bizarre « Yo, toi. J’ai trois questions pour toi. »
Je me suis arrêté. Par curiosité, ou peut-être à cause de cette autorité effrayante qu’elle dégage malgré sa si petite taille.
« Première question. Tu viens d’où ?
– Euh… De chez moi.
– Où t’es né ? Où t’as grandi, banane ! »
Son français n’est pas exceptionnel, mais le mot banane, elle le connaît.
Je lui ai expliqué. Je suis né dans le Nord, je suis venu à Paris pour mes études. Rien d’exceptionnel ni de très intéressant.
« Et toi ? »
Elle a eu une moue gênée, elle s’est gratté la tête.
Sur l’avant-bras, elle s’est fait tatouer un attrape-rêve amérindien.
« C’est compliqué. Je suis née au Kenya. Mais j’y suis restée que deux ans. Après ça… »
Après ça elle a passé une heure à essayer de me lister les endroits où elle avait vécu. Une heure pendant laquelle elle m’avait traîné de stand en animation pour me faire goûter ceci et me montrer cela, se faisant un devoir de m’expliquer à moi, pauvre français n’ayant jamais enjambé une frontière, qu’il y avait un monde à l’extérieur et tant de choses à découvrir.
Cette fête m’a-t-elle dit, c’est comme un avant-goût de ce qu’il y a dehors, un aperçu de ce que moi je rate en m’enfermant à Paris.
Enfermer, oui, c’est le mot qu’elle a employé.
Et là, je la suis sans savoir où on va, sans même savoir son nom, et elle me fait descendre des marches de pierre menant à l’arrière-cour du Danemark.
« Deuxième question » dit-elle en claquant sa bière sur la table.
Les Danois ont transformé leur jardin en bar, on a commandé à boire, on s’est installé, et moi j’essaye de manger ces grosses boules de pieuvre collantes sans m’en mettre plein les doigts.
Je tente une première bouchée.
Merde. C’est bon.
« Tu veux aller où ? demande-t-elle, menton levé, sourcils baissés.
– Comment ch’a ? Dans la vie ? Après ch’ette pinte ? »
Elle hausse les épaules.
« Comment tu comprends la question, ça fait partie de ta réponse. »
Elle veut savoir si je compte voyager, j’imagine.
Je réfléchis, je bredouille des idées. J’aimerais quitter un peu la France, oui, habiter ailleurs, un jour. Peut-être en Asie, pourquoi pas, et puis, visiter l’Australie, et les États-Unis aussi, je sais pas, pourquoi cette question ?
Elle avale une gorgée de bière. En posant le verre elle s’exclame quelque chose dans une autre langue et derrière elle un serveur danois se marre et lui répond dans un dialecte semblable. Ça doit être du danois, du coup.
Elle lève trois doigts. Ça veut dire dernière question.
À la base du majeur, elle s’est fait tatouer trois idéogrammes, peut-être chinois, ou bien coréens.
Elle lève les yeux de son verre et de sous ses cheveux, elle me lance un sourire de mille watts. Sans le savoir je vis un moment dont je me souviendrai encore, sept ans après, de l’autre côté du monde, et elle, penchée sur la table, elle me regarde droit dans les yeux, et elle me chuchote :
« T’attends quoi ? »
A propos de Quentin Marchal
J’habitais la Maison des Étudiants de l’Asie du Sud-Est. La MÉASE. Une dizaine de mois durant mes études en école d’ingé, à Télécom Paristech. C’était il y a des années déjà, mais le temps ne parviendra pas à estomper les souvenirs que je garde de cette brève étape de ma vie. De la cité U. De cet endroit irréel, cette miniature du monde bourrée de moments gravés dans ma mémoire et de rencontres improbables qui me collent un sourire à la figure chaque fois que j’y repense. Évidemment je suis toujours abonné aux newsletters de la Cité, je les reçois comme des piqûres de nostalgie régulières, et lorsque j’ai vu ce mail présentant le concours de nouvelles de cette année, j’y ai vu l’occasion de pouvoir me replonger dans ce passé, et de peut-être avoir une chance de partager par écrit tout ce que ce lieu a représenté pour moi.
Au sujet du 3ème concours 17 boulevard Jourdan
Le 3ème concours de récits 17 boulevard Jourdan s’est tenu de novembre 2015 à février 2016, invitant les participants à écrire une histoire réelle ou fictive, à la première personne, se passant à la Cité internationale et ayant pour thème « La Cité de la sérendipité », les hasards heureux.
Avec le soutien de :